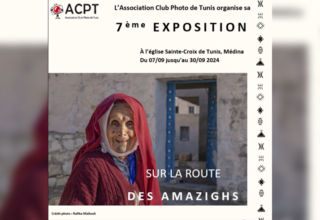Vivant et travaillant en Angleterre, Dora Latiri est tunisienne. Fille du célèbre ingénieur tunisien, feu Mokhtar Latiri, dont elle ne peut qu’être fière, elle a su tout de même beaucoup compter sur elle-même pour être et pour faire son chemin dans la vie. Un chemin lumineux, mais quelquefois jonché d’obstacles, qu’elle a conçu et voulu pour elle, indépendamment des désirs, des idéaux et de la volonté du père dont elle a tout de même hérité l’intelligence, le sens du devoir, la persévérance, le courage, mais aussi la passion pour les études, pour la recherche et pour la photographie.
Professeure universitaire de littérature anglaise et chercheure en arts et cultures à l’Université de Brighton, en Grande-Bretagne, après avoir été lexicographe à Paris et à Oxford, puis enseignante à l’Université de Tunis, elle est aussi artiste-photographe et a exposé ses photographies en Tunisie comme en Angleterre et au Canada.
Romancière francophone à la langue et au style pleins de vertus, elle a publié à Tunis, aux éditions Elyzad, en 2013, son premier livre «Un amour de tn.» où elle raconte, en alternant texte et photos, son retour au pays natal après le «14 janvier 2011» (Cf. notre article, La Presse de Tunisie, 3-4-2021). Son deuxième récit ou plutôt «photoautobiographie» est sorti en 2020, à Sousse, chez «Contraste Editions», sous le titre de «Citrons doux, L’Aînée».(Cf. notre article, La Presse de Tunisie, 1-5-2021). Entretien.

Vous avez publié, en 2013, en Tunisie, votre premier livre «Un amour de tn» qui est «un carnet photographique» de votre propre retour au pays natal, après les événements ayant secoué notre pays entre le 17 décembre 2010 et le 14 janvier 2011 et qu’on a appelés «révolution». Où étiez-vous avant de rentrer au pays ? Etiez-vous par hasard interdite de séjour en Tunisie ?
Je vis à Lewes dans le sud de l’Angleterre, non loin de Brighton, depuis 1997. J’y suis ‘Senior Lecturer’ (l’équivalent de professeur des universités) dans la School of Humanities (Faculté des Sciences Humaines) et chercheure dans le centre de recherche Centre for Memory, Narrative and Histories (Centre de recherche Mémoire, Récits, Histoires). Entre 1994 et 1997, j’ai été en poste à l’université de Tunis à la Faculté du 9-Avril et à l’Institut Bourguiba des Langues Vivantes où j’ai enseigné la linguistique et la littérature dans les départements de français. Avant 1994, je vivais à Oxford où j’ai travaillé comme lexicographe bilingue. Avant Oxford, je vivais à Paris où j’ai fait mes études supérieures qui m’ont conduite à un poste de lexicographe et assistante de Josette Rey à la maison d’édition Le Robert. A Paris puis à Oxford, j’ai contribué à la rédaction de nombreux dictionnaires monolingues et bilingues. J’ai postulé pour l’Université de Tunis après une reprise de contact avec ma famille peu après la naissance de ma fille en 1993. Mon fils est né en 1989 et n’a rencontré ses grands-parents maternels qu’à l’âge de quatre ans. J’ai aussi vécu au Liban et vécu et travaillé en Arabie, à Jeddah, pendant deux ans. Je n’ai jamais été interdite de séjour en Tunisie mais je me suis mariée deux fois avec des étrangers et cela a été très difficile à vivre pour mes parents. C’était scandaleux. Je pourrais dire que j’ai vécu une sorte de mort sociale en Tunisie et une forme de bannissement. Avec les années, le désir de mes parents de renouer avec moi a été plus fort que le devoir qu’ils ressentaient de me rejeter.
Pourquoi avez-vous éprouvé le besoin d’écrire ce livre ? Ladite «révolution» vous a-t-elle fait aimer la Tunisie, votre passé, vos racines, votre identité première, plus que vous l’aimiez avant ?
Les événements du 17 décembre et du 14 janvier ont déclenché en moi —comme en tant d’autres— une espérance immense et un désir de prendre part. Ecrire ce premier livre a été pour moi une mise en visibilité de moi-même mais aussi de la complexité et de la diversité tunisiennes. Il m’a paru important de témoigner de nos identités plurielles alors que des discours de plus en plus réactionnaires commençaient à se faire entendre et à se saisir du mouvement révolutionnaire. La forme du livre : le style multilingue comprenant le français, la «darja» tunisienne ainsi que d’autres dialectes arabes, l’insertion de photographies… s’est aussi nourrie des audaces de la Révolution. Quant à l’écriture en français, il m’apparaissait encore plus important de publier dans cette langue —ma première langue d’écriture— alors que son usage était dénoncé comme une trahison néocolonialiste.
Mon passé, mes racines, mon identité première, comme vous le dites si bien ne m’ont jamais quittée, où que je sois. J’ai ressenti une grande souffrance et même un sentiment de honte devant le rejet de mes parents pour le mariage ‘mixte’ lorsqu’il touchait leur famille alors qu’ils étaient plutôt ouverts sur le monde. Je n’imaginais pas qu’ils pouvaient être si inflexibles pendant si longtemps.
Vous évoquez non sans quelques éloges Mohamed-Tarek Bouazizi dans le nom de qui vous soulignez le «az» (la dignité) et que beaucoup considèrent comme l’homme par qui tout est arrivé. Ne vous arrive-t-il pas aujourd’hui de douter un peu de cet homme et de tout ce qui a été considéré, peut-être sans beaucoup d’objectivité, comme une «révolution», quand vous voyez l’état politique, économique et social dramatiquement catastrophique auquel s’est réduite aujourd’hui la Tunisie. Pensez-vous vraiment aujourd’hui que la Tunisie ait réellement vécu une «révolution», une vraie ?
Il est indéniable que la Tunisie a connu un moment historique révolutionnaire. Dix ans après, dans un contexte particulièrement difficile et aggravé par la pandémie et son impact sur les infrastructures et l’économie, c’est désespérant de mesurer la gravité de la situation sociale. Mohamed Bouazizi incarne encore hélas un désespoir poignant. Je ne sais pas ce qu’aurait été une “vraie” révolution, peut-être que le coût en vies humaines aurait été encore plus lourd ? Sur le plan politique, les systèmes archaïques de corruption et d’exploitation sont toujours là, les Tunisiens et les Tunisiennes méritent mieux.
Outre le français, la langue dans laquelle vous avez écrit votre livre, on trouve dans votre texte beaucoup de phrases en dialecte tunisien que vous insérez dans votre discours telles quelles d’abord et que vous traduisez en français ensuite. Quel est l’intérêt particulier de ces phrases par rapport à votre narration autobiographique ?
Le mélange des langues exprime nos complexités linguistiques qui sont niées par le monolinguisme strict. Le tunisien est notre langue maternelle et son statut reste peu valorisé, c’est tragique. J’ai écrit dans ces mélanges de langues parce que sur le plan littéraire, d’une part, je me suis inspirée des auteurs modernistes/post-modernistes que nous enseignons dans mon département de littérature en langue anglaise (Virginia Woolf, Samuel Becket, James Joyce…) et de leur pratique du “stream of consciousness” (le monologue intérieur) pour transcrire mes pensées telles qu’elles émergeaient, et comme je suis multilingue, mes pensées le sont aussi ; d’autre part, je pouvais aussi m’appuyer sur les travaux linguistiques portant sur l’alternance codique auxquels j’ai contribué avec mon excellent ami et collègue, l’éminent professeur Foued Laroussi de l’Université de Rouen où il a longtemps dirigé le laboratoire Dylis (Dynamique du Language in Situ).
Le poète martiniquais Aimé Césaire a publié en 1939 son œuvre majeure «Cahier d’un retour au pays natal» qui est, comme vous le savez, un long texte écrit en vers libres et où il signifiait que son retour à son pays natal, après le séjour à Paris, s’accompagnait surtout de sa prise de conscience de l’injustice dans laquelle vivaient ses concitoyens noirs. Le sous-titre que vous avez donné à votre récit autobiographique est «Carnet photographique d’un retour au pays natal après la Révolution». De quelle prise de conscience particulière est accompagné votre retour à vous en Tunisie, évoqué dans ce livre où le discours textuel rencontre le «discours» de la photo, celle qui est faite par vous-même ?
Le livre de Césaire est un livre fondateur, il y combat le racisme, l’assujettissement de l’homme par l’homme ; la langue y est puissante, foisonnante, elle est revendiquée un peu à la façon de ce butin de guerre dont parle Kateb Yacine. En Tunisie, la lutte contre les modes d’exploitation et d’aliénation du colonialisme sous ses diverses incarnations peut aussi se reconnaître dans les mots de Césaire. En me référant à l’œuvre de Césaire, j’ai voulu suggérer que le moment révolutionnaire était un moment où un nouveau peuple pouvait naître, libéré du joug des dictatures (dont le patriarcat). Le livre de Césaire est aussi un livre dans lequel se reconnaissent les exilés dans cette tension contradictoire d’appartenance et de distanciation.
Il y a bien souvent dans votre texte des phrases courtes et incisives ou des phrases qui se construisent, de manière quelque peu lâche, en petits fragments ; il y a des inversions, des répétitions lexicales, des bribes extraites de conversations ou de répliques, bref un style léger, fort peu construit, et comme impressif et onirique qui semble reproduire des émotions, des chuchotements intérieurs, des frémissements, des rêves imprécis, nuageux, des réminiscences flottant dans l’ombre de la mémoire telles des images floues ou en demi-teinte, plus qu’évoquer des référents matériels. On croit y reconnaître un peu le style de Marguerite Duras surtout dans «L’Amant» ou dans «Emily L» ou encore dans «Un barrage contre le pacifique». Avez-vous beaucoup lu cette romancière française ? Seriez-vous d’accord que son écriture a influencé peu ou prou votre univers scripturaire ?
J’ai beaucoup lu Marguerite Duras, je la lis et la relis, et naturellement je suis influencée par elle. Pas seulement par son écriture mais aussi par sa photographie et son cinéma. Je l’ai enseignée et j’ai beaucoup exploré de près son écriture, plus particulièrement dans son recueil de textes courts rassemblés dans «La Vie matérielle» que j’ai enseigné dans sa traduction en anglais sous le titre «Practicalities» . J’ai aussi beaucoup lu Assia Djebar, je me suis rendu compte bien après avoir publié «Un Amour de tn» que j’avais été très inspirée par son livre «Le Blanc de l’Algérie».
Vous avez publié, en 2020, votre deuxième récit qui s’intitule «Citron doux, l’Aînée» qui est une chronique familiale dédiée à la mémoire de la sœur aînée. Comme dans le premier livre, des photos en noir et blanc accompagnent la narration. Quel apport précis aurait la photo dans cette interaction Texte-Image ? Que pourrait-on y trouver : un surplus de signification ou plutôt de l’émotion ?
La relation entre texte et photographie est vraiment difficile à déconstruire. En anglais on dirait «it is greater than the some of the parts» (Le tout est supérieur à la somme des parties).
Je sais que j’écris beaucoup dans ma tête et je sais aussi que je suis accompagnée d’images qui surgissent. J’ai grandi parmi les photos et parmi les livres. J’ai toujours aimé les livres d’art qui sont textuels et visuels. Le premier livre mêlant photos et récit autobiographique qui m’a marquée est celui de Sophie Calle, «Suite vénitienne», que j’ai découvert à la suite d’un article dans «Libération» en 1983 et dont j’ai continué de lire les livres et de visiter les expositions. Lorsque j’ai lu ce premier livre de Sophie Calle, je me suis dit que c’est exactement ce que je voudrais faire. Il m’a fallu de longues années avant d’arriver à trouver un mode d’expression qui soit le mien et surtout que j’ose me révéler dans un récit personnel . Je voudrais saluer ici la pionnière du récit de vie tunisien en langue française sous la forme du journal intime, notre bien-aimée Jelila Hafsia. Je publie, par ailleurs, des travaux universitaires en tant que chercheure, certains avec des photos, et j’ai publié sur la photo. Je lis et je m’inspire des écrivains mêlant photos et texte : W.G.Sebold, Hervé Guibert, et plus près de nous Colette Fellous que j’ai eu le privilège de rencontrer et sur qui j’ai publié.
Vous êtes professeur de littérature à l’Université de Brighton, en Grande-Bretagne. Comment avez-vous atterri dans cette ville et dans cette université ?
Ma première carrière a été dans la lexicographie, ma thèse de linguistique portait sur la sémantique lexicale. J’ai commencé à travailler pour une maison d’éditions à Londres sur un projet de dictionnaire bilingue, puis j’ai été recrutée aux Dictionnaires Le Robert à Paris. J’ai par la suite été recrutée à «Oxford University Press», à Oxford en Angleterre, pour une série de dictionnaires bilingues dont la publication s’est étendue sur plusieurs années. Je suis retournée en Tunisie en 1994 et j’ai été en poste à la Faculté du 9-Avril et à l’Institut Bourguiba des Langues Vivantes. J’ai été recrutée par «l’université de Brighton», en 1997, j’y enseigne en anglais dans le département de littérature et dans le département de linguistique après y avoir commencé ma carrière en French Studies (études françaises et francophones).Je dirige des travaux de recherche dans le domaine des “Arts and Humanities” (arts et sciences humaines).
Vous êtes la fille de feu Mokhtar Latiri, célèbre ingénieur tunisien, ancien élève du Lycée Louis-Le-Grand, en France et diplômé, en 1951, de la prestigieuse «Ecole nationale des ponts et chaussées», de Paris, qui a dirigé en Tunisie les premiers grands travaux d’aménagement du territoire, qui a fondé, en 1968, «L’Ecole nationale d’ingénieurs de Tunis» (l’Enit) et qu’on considère comme le Doyen des ingénieurs tunisiens. Vous l’évoquez d’ailleurs très discrètement dans votre «amour de tn». Outre la fierté ordinaire que tout un chacun éprouve normalement par rapport à ses parents, quel autre sentiment particulier fait naître en vous la mémoire de ce grand homme, de ce papa ? Votre passion pour la photographie serait-elle l’une des traces qu’il a laissées en vous, lui qui a réalisé différentes expositions des nombreuses photos prises par lui-même notamment au Sahara de Tunisie ?
Je suis toujours très émue à l’évocation de mon regretté père. Je l’adorais et le craignais en même temps. C’était notre père et aussi un personnage public, ce qui est très inconfortable à vivre. C’était très difficile d’être sa fille, il était très exigeant et avait une idée très précise de ce qu’il attendait de ses filles : il fallait être ingénieur et servir son pays. J’ai souvent eu tout faux avec lui et c’est triste. J’ai beaucoup appris de lui en l’observant dans sa pratique de photographe et en parcourant les ouvrages et revues de photographies qu’il recevait. Pour lui rendre hommage et donner de la visibilité à sa créativité photographique, j’ai publié un chapitre comportant une sélection de ses photographies dans un ouvrage de référence sur la photographie en Afrique : le chapitre s’intitule «Photographic representations of Tunisian women from the late 1940s to the present : A transgenerational palimpsest», le titre de l’ouvrage est : «Women And Photography In Africa».(Newbury, Darren et al. Routledge, London & New York, 2021).
Pour terminer, vous révélez dans vos récits le profond et fidèle attachement que vous ressentez pour votre pays natal auquel vous rendez, d’une certaine manière, un bel hommage dans ce que vous écrivez, mais vous êtes établie depuis de nombreuses années en Europe. Comment expliquez-vous cet éloignement au moment-même où vous êtes si attachée à la Tunisie dont vous dites en faire partie et dont vous désirez rêver l’avenir avec les autres qui y croient encore ?
Comme beaucoup de migrant.e.s, j’ai longtemps caressé un projet de retour. Ce projet s’est réalisé en 1994 mais les circonstances où je me suis trouvée avec mon mari anglais et nos enfants se sont révélées plus difficiles que je n’avais anticipé. J’ai de nouveau imaginé que je pourrais revenir au moment de la Révolution mais ce n’était pas réaliste. Je ne sais pas quand je retournerai, le pays me manque. D’être publiée et lue en Tunisie, c’est un peu une forme de retour. Merci de me donner l’occasion de m’exprimer à ce sujet.